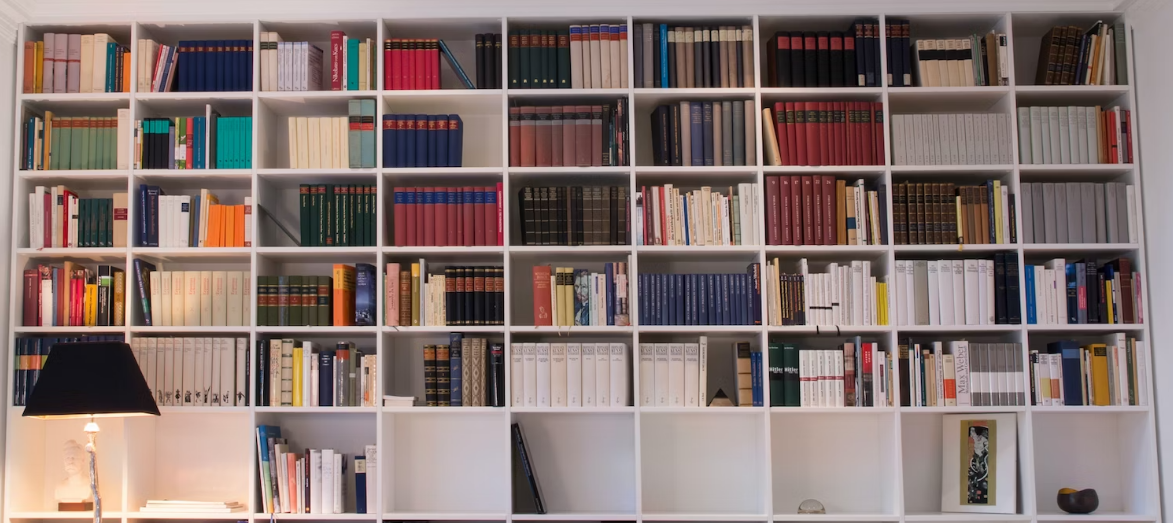Dans les contes de l’ouest-africain, aucune temporalité homogène ne structure les destins des personnages humains et animaux, vivant dans un même monde. Le temps lointain s’actualise et devient moment présent, temps unique d’un récit fragmenté évoquant la cohabitation de l’homme et de l’animal qui se côtoient, se parlent et vivent des aventures communes. Birago Diop, puis Senghor et Sadji mettent l’accent sur la fonction éducative du conte qui enseigne, entre autres, à travers des situations vécues par leurs personnages, les valeurs de sagesse, de prudence, de mesure et de solidarité. C’est pourquoi nous nous arrêterons seulement sur leurs intentions pédagogiques et sur les démarches qui sous-tendent la mise en récit du patrimoine.
Birago Diop, vétérinaire de formation, qui a accompagné le combat de la négritude à travers ses Contes d'Amadou Koumba (1947) et ses Nouveaux Contes d'Amadou Koumba (1958), ainsi que dans le domaine de la poésie, témoigne bien de ce monde unifié. Son inspiration repose sur le patrimoine oral de la sous-région ouest-africaine. Abdoulaye Sadji, pour sa part, s'est surtout illustré dans le roman et la nouvelle, Senghor dans la poésie et l'essai. La culture, ferment de l'épanouissement moral est la base identitaire de leur création. Celle-ci se nourrit, de façon essentielle, chez Birago, du dire des anciens et des Sages africains et, chez Senghor et Sadji (La Belle Histoire de Leuk-le-lièvre, 1953) des sources populaires de la tradition orale. Les racines du conte plongent donc dans la mémoire historique des peuples de l'espace soudano-sahélien.
Birago qui se fait rapporteur de la parole ancestrale tire sa sensibilité de ce tréfonds culturel. Aphorismes, proverbes et dictons apparaissent au fil du récit, pour aider à dégager une leçon de vie. Sa connaissance du règne animal est alimentée par son expérience professionnelle de médecin africain, ce qui lui donne la capacité d'attribuer à chaque animal des traits distinctifs, qui s'accommodent de toutes les tonalités d'humour (joyeux, plaisant, noir, etc.). Dans le conte Maman Caïman, comme dans la plupart, le récit assume un ancrage dans la pensée des sages, par le biais des proverbes. Il y enseigne la prudence et la nécessité d'éteindre tout foyer d'incendie ou de tension sociale, pour contrecarrer l'irréparable, et convoque, en association, un proverbe qui verbalise la séquence.
Senghor et Sadji n'inventent pas non plus, à proprement parler, les histoires racontées ; ils transmettent des récits recueillis, avec un sens déjà fixé culturellement. Mais on sent une volonté de transmettre des valeurs morales sous la forme d’un corpus alternatif rapporté au monde moderne et à la connaissance scientifique. On peut voir, par exemple, Bouky l'hyène confronter, dans un acte pédagogique pertinent, la version traditionnelle de l'éclipse lunaire et l'explication scientifique, pour satisfaire la curiosité de ses enfants.
Par ailleurs, la peinture des caractères, dans l'univers des contes de Senghor, et Sadji qui s'occupe surtout de l'orientation didactique, s'opère dans le contraste Bouki vs Leuk. Il faut bien observer que chez Diop, principalement, Bouki, « l'autre de Leuk », se reconnaît pourtant par un certain bon sens et la méfiance devant l'inconnu. Mais son sort demeure celui de l'éternel vaincu, du perfide parfois blessé par ses propres armes. Il est intéressant de retenir que cette peinture se rapporte toujours aux circonstances de temps et de lieux, ce qui met au cœur des univers créées, la figure de l’animal voyageur, engagé symboliquement dans le parcours non prédéfini d’un circuit initiatique. Ces personnages du conte ne se révèlent alors aux autres protagonistes et aux lecteurs que dans les situations problématiques rencontrées à cette occasion.
Il s'agit d'une démarche analytique et illustrative, dans des séquences autonomes, une dimension qui n'est évidemment pas absente chez les auteurs cités plus haut, en l'occurrence Senghor et Sadji. Mais, de façon largement perceptible, cette orientation est sous-tendue par une démarche de type synthétique et analogique, pour mieux coller aux stratégies éducatives des enseignants de l'école primaire.
En définitive, l'imaginaire dans La Belle aventure de Leuk-le-lièvre de L.SS et A Sadji et les Contes et Nouveaux contes d'Amadou Koumba de Birago Diop, servie par l’épaisseur psychologique des personnages d’animaux, se met au service de la cause communautaire et de la formation des jeunes. Au-delà de l'amusement, il y a une visée didactique qui redéfinit implicitement les fondements de l'identité. Au demeurant, dans les préoccupations des conteurs, se profile la figure du sachant qui prend les visages du sage et du pédagogue.
Pr. Birahim Madior Thioune