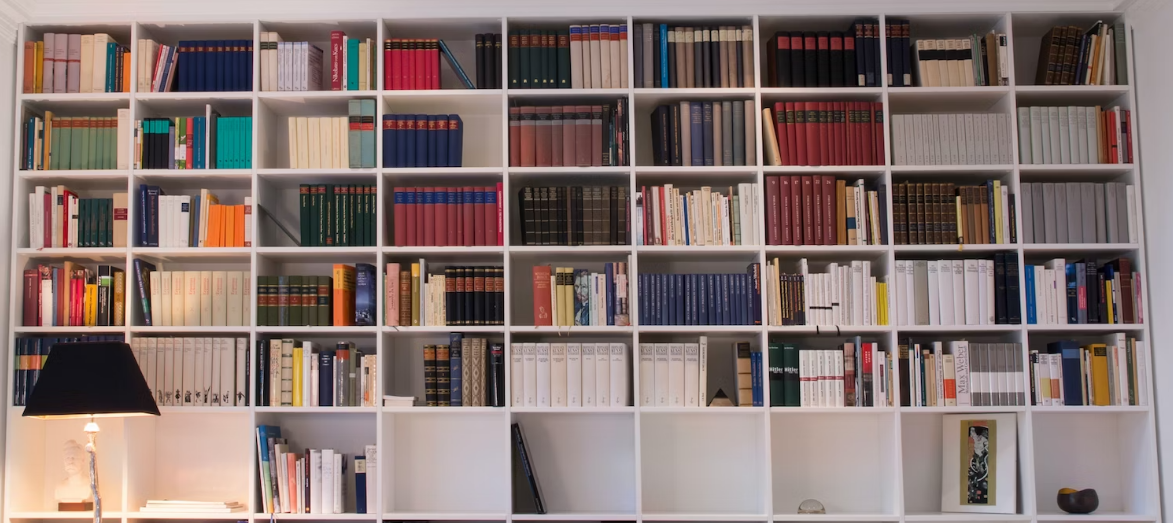Négritude et luttes armées en Afrique
Sur le plan de l'écriture littéraire, on note une sorte de rejet ou d'adaptation de la négritude théorique, s’affirmant dans une négritude comme expression du vécu local, par exemple en Angola et au Mozambique. On observe évidemment la part du modèle américain dans la négritude originelle et dans le contexte du Cap- vert, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que les poètes lusophones sont allés boire à la même source que les théoriciens de la négritude des années 30, en France : le mouvement panafricaniste en Amérique. On peut retenir que le Cap-vert a pour sa part fortement subi l'influence brésilienne.
Le Pr Haydara montre, de façon magistrale, comment la littérature lusophone d'Afrique (poésie, conte, roman) s'est constituée en champ d'expression original et de recherche. C'est vraiment tout le mérite de M. Haydara. Au-delà de la dimension heuristique, se profile, précisément, tout un espace discursif qui témoigne de la conscience historique des Africains en quête d'indépendance. Ce que cet essai révèle, c'est un contexte de méconnaissance du fait culturel dans l'action revendicative, au sein des pays comme l'Angola, le Cap Vert, Mozambique.
L'histoire littéraire s'est essentiellement faite au profit de la littérature francophone (en rapport avec le type de colonisation, l'influence mondiale des hommes comme Senghor et Alioune Diop, etc.). L'évocation des origines du mouvement de la négritude laisse dans l'ombre des contours bien méconnus, jusque-là. Désormais, avec ce livre, on peut voir sous l'étendard de la négritude, et à partir d'une autre filiation, le travail important d'écrivains lusophones comme Agostinho Neto, Luandinho Viera, Boaventura Cardoso, Noémia de Souza. Car c'est bien une filiation des écrivains de l'espace lusophone qui s'établit à partir de personnalités américaines comme Countee Cullen, Langston Hugues, Claude Mac Key, Web Dubois, et autres. Ainsi, des noms seront mieux connus, sous la bannière de la négritude, dans l'espace lusophone, Manuel Ferreira, Craveirinha, Neto, etc.
Remarques
→ Le style narratif africain est adapté à l'écriture dans la langue du colonisateur.
→ L'histoire devient objet de réécriture
→ La littérature est utilisée comme un outil pour l'engagement et la mobilisation des énergies, dans la lutte de libération
→ Les auteurs procèdent même à une mise en scène de la fin de la domination coloniale.
Le Pr. Haydara est donc un panafricaniste et un scientifique authentique. Son livre a une portée littéraire et documentaire qui rappelle les effets du Code de l'indigénat et du travail forcé dans les pays colonisés. Il offre dans ce remarquable travail, un panorama de la littérature lusophone, apparue comme un aspect important du vaste mouvement intellectuel qui a mené aux indépendances.
Prof Birahim Madior Thioune